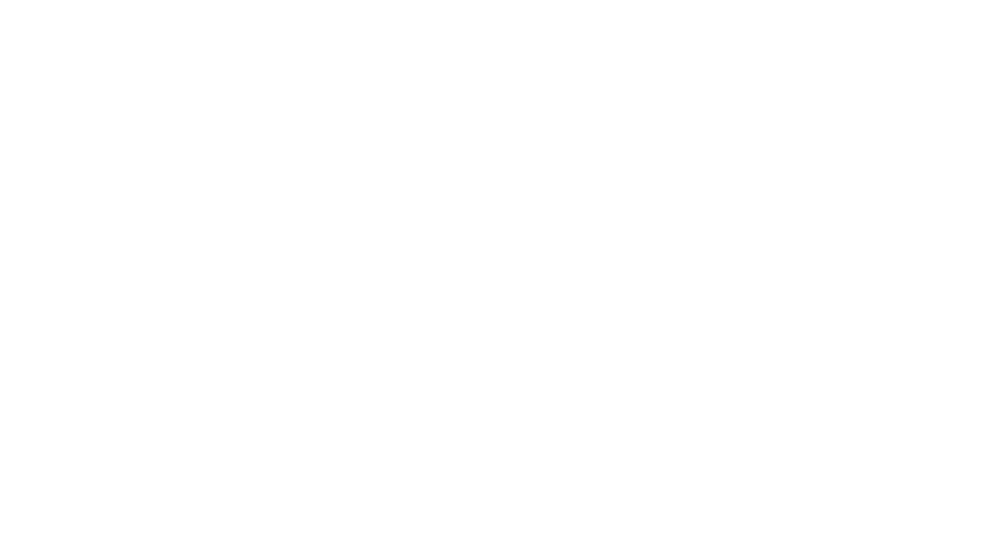Nabil Ayouch revient sur les écrans avec Everybody loves Touda, l’histoire d’une jeune femme qui rêve de devenir chikha. Le film fait partie de la sélection officielle du prochain Festival de Cannes qui démarre ce 16 mai 2024. L’occasion pour Shoelifer de rencontrer ce cinéaste engagé.
Après Haut et Fort dédié au hip-hop, Nabil Ayouch nous plonge dans l’univers de la Aïta, à travers le personnage de Touda, une mère célibataire qui se produit tous les soirs dans les bars de sa petite ville de province. Cet art populaire, souvent marginalisé (et en voie de disparition) a toujours suscité l’admiration autant que le mépris. Peut-être parce qu’on envie la liberté de ton qui fait des chikhates des féministes avant l’heure. Ou parce qu’on pointe la légèreté (supposée) de leurs mœurs… Dans Everybody loves Touda, Nabil Ayouch rend hommage à ces poétesses mail aimées. Entretien.
Après le hip-hop, la Aïta ?
On peut dire ça comme ça, oui (rires). Au-delà de la Aïta, c’est avant tout une rencontre avec des femmes qui hantent mes films depuis de nombreuses années déjà, depuis Les Chevaux de Dieu… Et aussi des discussions que j’ai eues par la suite avec d’autres chikhates pour préparer ce film. À chaque fois, il y avait cette conviction forte du rôle fondamental joué par ces femmes au sein de la société marocaine.
À lire aussi : EXPOSITIONS 2024 : 7 EXPOS À NE PAS MANQUER !
Des femmes autant adulées que méprisées…
Oui, il y a une certaine ambivalence à ce sujet. Ce sont de véritables artistes qui sont à la fois porteuses d’un très bel héritage, une poésie chantée qu’est la Aïta et en même temps on sent qu’à partir du milieu du 20e siècle, leur image a changé auprès de la population. Dès lors qu’elles ont dû faire des compromis en allant en ville pour chanter dans les cabarets et dans les mariages. Le conservatisme aidant, évidemment… C’est cette ambivalence, ce paradoxe, ce statut d’héroïnes mal aimées finalement qui m’ont intéressé et que j’avais envie de traiter dans ce film.
Selon vous, pourquoi on ne les aime pas ?
Le rapport entre les chikhates et la société est très ambigu. Elles sont capables de réveiller chez le public, hommes et femmes confondus, des émotions absolument phénoménales. La puissance de leurs chants transcende toutes celles et ceux qui les écoutent. Je pense que le fait même de se laisser aller et porter par ces chants, c’est quelque chose qu’on refuse. Et ces femmes sont l’incarnation de cette transformation de l’individu qui s’opère à travers le chant et le rythme dès qu’elles s’emparent du micro. Je pense aussi que ce pouvoir qu’elles ont notamment vis-à-vis des hommes est quelque chose qui dérange profondément …
De plus, être capable de mettre de l’ambiance dans différents endroits, y compris des lieux où y a de l’alcool et de l’argent, suffit à les cornériser et à les réduire à autre chose. Ce sont ces stéréotypes là que je dénonce dans ce film. Il faut vraiment se rappeler qui elles étaient et qui elles sont encore aujourd’hui.
Le film raconte donc l’histoire de Touda qui quitte son village pour devenir chikha.
Oui, c’est l’histoire d’une femme en quête d’émancipation… Elle vit dans son petit bled et elle a des rêves. Depuis qu’elle est gamine, elle s’entraîne aux rythmes et à la taârija pour devenir chikha. Elle connaît toutes les aïoutes par cœur. Elle porte ce rêve en elle comme un désir d’élévation sociale à travers son art. Elle veut être considérée avant tout comme une artiste. Elle a un petit garçon qui est malentendant et à qui elle veut offrir un avenir meilleur, à travers l’éducation. Elle va donc se servir de la seule arme qu’elle a : le chant. Et elle sait que pour y arriver, elle doit quitter son village et partir vers la ville des lumières, Casablanca.
Nisrine Erradi qui joue Touda, chante et danse dans le film. Comment s’est-elle préparée pour incarner son personnage ?
Nisrine a travaillé comme une acharnée pendant un an et demi avant le tournage. Elle était coachée par des chikhates, dont Khadija El Bidaouia qui est morte pendant la préparation, et Siham Mesfiouia, une jeune chikha “puriste” et qui est l’une des rares de sa génération à être porteuse de la tradition de la Aïta.
Elle s’est donc formée au chant, au rythme, à la taârija… Elle s’est entraînée à bouger comme elles, à parler comme elles. Elle a fait un travail absolument phénoménal pour être crédible dans le rôle de Touda.
À lire aussi : FESTIVAL DE CANNES 2022 : RENCONTRE AVEC MARYAM TOUZANI, LA RÉALISATRICE DU BLEU DU CAFTAN
Votre film a été sélectionné dans la catégorie « Cannes Première », une première pour un réalisateur marocain…
Oui, mais il n’est pas en compétition. « Cannes Première » c’est un peu le prestige de la sélection officielle cannoise où l’on retrouve des auteurs confirmés comme Léos Carax, Emmanuel Courcol.
Vos films sont parfois clivants et font souvent débat, même en dehors du Maroc… À chaque fois, vos personnages sont des marginalisés du système : prostitués homosexuels, jeunes des quartiers défavorisés… Est-ce que vous trouvez qu’il est plus facile de faire ces films engagés en 2024 au Maroc qu’il y a 10 ans ?
Oui et non. Je pense que le Maroc a évolué sous pas mal d’aspects et en même temps, il y a des conservatismes qui sont encore très présents. Peut-être plus présents qu’il y a dix ans mais sous d’autres formes qui viennent souvent plus du public d’ailleurs. La preuve avec la réforme en cours de la Moudawana qui a suscité des réactions fortes dans les camps conservateurs. Dès qu’on veut toucher au statut de la femme, à la polygamie, à l’héritage ou encore au mariage des mineurs, il y a une levée de boucliers terrible.
Les choses changent, c’est certain, mais il y a des réflexes conservateurs qui sont encore bien là. Et en même temps, il y a cette jeunesse marocaine extrêmement vivante, qui s’exprime sous toutes les formes possibles, que ce soit à travers le cinéma, les arts de la rue, la chanson, la danse… La société est en mouvement. Et quelque part, ces deux aspects de la société sont au cœur du débat public. D’un côté, il y a cette envie de s’ouvrir et d’aller vers la modernité, et d’un autre côté il y a une catégorie de la population qui est réfractaire au changement. On vit dans une société un peu paradoxale, schizophrène sur certains sujets.
Photo (c) : Nabil Ayouch