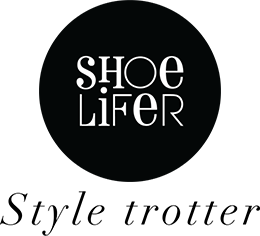N.m., souvent utilisé au pluriel pour se référer à une bande de tissu rapporté qui, froncée, plissée ou à plat et évasée, sert de garniture à une jupe, une robe, une manche, un col ou un pantalon. Femme à volant, danger au tournant ? Avant l’engouement du printemps-été 2016, de la copine de Zorro, de la cruise 2017, des flamencas et des aristos de 1700, il faut remonter très loin pour découvrir l’origine du volant. Si la technique du volant s’applique avec entrain vers 1870 pour notamment les robes à crinoline, dont le dernier modèle est même baptisé « balayeuse », c’est en Allemagne que dès 1500 on trouve les premiers fous du volant. À l’époque, on porte alors deux couches de vêtements, tandis que l’Espagne invente les premiers volants pour créer des cols à fronces amovibles. À partir de 1600, la Reine Elizabeth affiche des cols à fronces démesurés, comme d’énormes colliers. Vers 1700, c’est la période ornementale du volant qui transparaît non seulement sur les cols mais aussi sur les robes, celles de Marie Antoinette par exemple, dont ils seront le symbole de l’extravagance (jusqu’à être responsable de sa mort ?). En 1920, les volants prennent un tournant plus sage, ils s’appliquent sur des silhouettes plus graphiques. Dans les années 50, on plébiscite le volant symbole d’une féminité fantaisiste et généreuse en opposition à la précarité et l’austérité de la guerre tout juste achevée. Puis en 1970, c’est l’ère hippie qui s’empare de la technique si appropriée à de longues robes de gitanes, parfaitement en adéquation avec l’humeur générale. Les années 80 transformeront le volant en un imposant ornement parfois affreux, qui vagabondera de la robe de mariage de Lady Di aux tenues discrètes des clubbers de cette décennie. En 2016, le volant s’associe à des tops aux épaules dénudées pour des silhouettes de danseuses sensuelles. La tendance hispanique poursuit son chemin jusqu’aux collections resort 2017 qui annoncent du volant à tout va sur des robes de flamencas et des blouses d’innocentes séductrices.