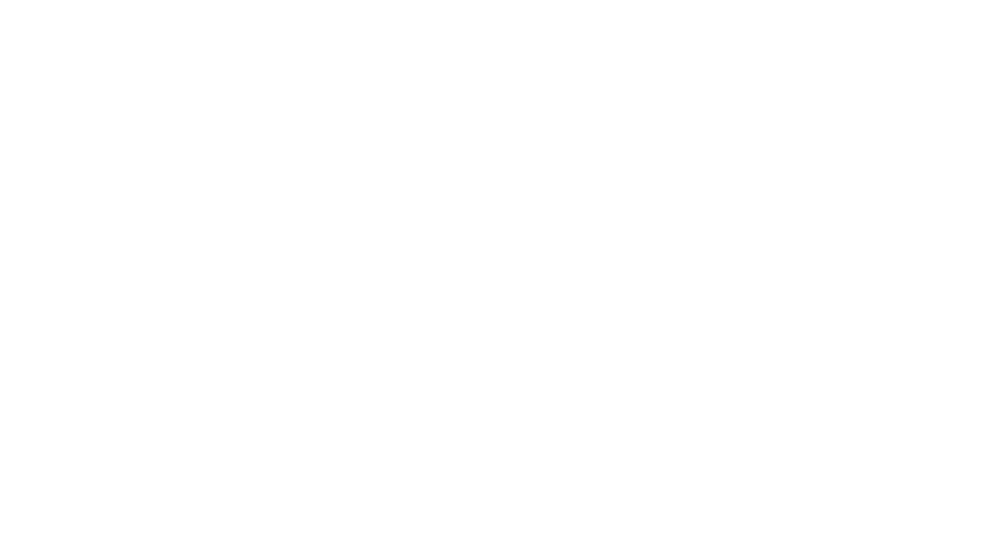La mode, la mode, la mode. Vous savez comme on l’aime, on aime donc rencontrer ceux qui la font. Comme Karim Adduchi, nouveau génie (marocain) des ciseaux, acclamé par la critique internationale. Interview.
Retenez bien son nom. Depuis qu’il a lancé sa marque éponyme en 2015, Karim Adduchi a le vent en poupe. En 2018, il intégrait le prestigieux “30 under 30” du magazine Forbes. Un classement annuel regroupant les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes d’Europe, dans le domaine des arts et de la culture. Et tout récemment, le fashion designer originaire du Rif a remporté le deuxième prix du Vogue Fashion Prize 2020. À la clé ? Une subvention de 50.000 dollars pour développer sa marque de mode féminine et une présentation de ses pièces dans un showroom exclusif à l’occasion de la prochaine fashion week parisienne, en mars 2021.
En dépit de son ascension fulgurante, le jeune homme, très accessible, est loin d’avoir pris la grosse tête. Pour Shoelifer, il revient volontiers sur son enfance (en partie) marocaine et sur les influences de cet héritage dans son travail. Caftan revisité, collection “Maktub”, étoffes inspirées des motifs du désert ou des montagnes de l’Atlas… le Maroc est omniprésent dans son travail. Artiste multidisciplinaire, engagé et profondément optimiste, Adduchi dessine avec brio le nouveau visage de la couture contemporaine.
Pouvez-vous nous parler de votre enfance au Maroc? Quels souvenirs en gardez-vous?
Karim Adduchi : Je suis né dans un petit village du Nord, appelé Imzouren. Ma vie quotidienne consistait à voir ma mère, ma tante et ma grand-mère travailler et s’occuper de la maison. Ma mère était couturière, donc j’ai grandi au milieu des machines à coudre et des tissus. Elle dessinait et découpait des patrons, tandis que ma grand-mère brodait. J’ai des souvenirs très paisibles de cette époque, surtout de mes 5 premières années, avant que nous ne partions pour l’Espagne. C’était la meilleure période de ma vie. J’aime beaucoup m’y replonger, en pensée, notamment lorsque je crée.
Vous avez ensuite déménagé en Espagne pour rejoindre votre père ?
Oui, mon père, qui était tailleur, s’y était installé depuis plusieurs années et nous l’avons rejoint avec mon frère et ma mère. Je n’ai d’ailleurs pas de souvenirs de lui au Maroc, donc j’ai l’impression de l’avoir rencontré pour la première fois lorsque je suis arrivé là-bas. C’était très déroutant de changer de pays aussi jeune, tout était différent: la culture, la nourriture, les odeurs, la langue… Comme je ne parlais ni catalan ni espagnol, je suis resté silencieux durant 2 ou 3 ans. Je ne faisais qu’observer et absorber tout ce qui se passait autour de moi. Mes instituteurs ont fini par dire à mes parents que je devais être autiste. Disons que j’étais un enfant solitaire qui préférait créer et faire des choses avec ses mains, au lieu de sortir et d’aller jouer au football comme les autres. Mes parents m’ont inscrit dans une école d’art, pour voir si je pouvais apprendre à communiquer différemment, et c’est là que tout a commencé. C’est là-bas que j’ai appris à peindre, à dessiner, à sculpter… et que je me suis mis à parler.
C’est donc à l’école que vous est venue l’envie de devenir designer ?
Non, je ne dirais pas ça. L’enseignement dans cette école d’art était très classique: chacun devait créer ses propres pigments et fabriquer ses propres toiles avant de commencer à peindre. C’était extrêmement formateur, mais pour moi la pratique artistique était avant tout un moyen de communiquer, je ne la voyais pas comme une vocation. Je passais mes journées à créer et lorsque je rentrais à la maison, je voyais ma mère concevoir des robes : c’était donc parfaitement naturel, pour moi, de faire des choses avec ses mains. C’était mon quotidien. À cette époque, je ne voulais pas être styliste, je voulais être artiste. C’est seulement lorsque j’ai quitté Barcelone pour Amsterdam, en 2010, que j’ai commencé à m’intéresser à la mode.
Et comment vous définissez-vous aujourd’hui ? Comme un artiste ?
Oui, un artiste universel. Je viens du Maroc, j’ai grandi en Espagne et étudié aux Pays-Bas. Aujourd’hui, je vis entre Amsterdam et Paris, mais je vais au Maroc autant que possible. Tout m’influence et je suis tout à la fois.
Comment travaillez-vous pour concevoir une collection ?
Je ne fais jamais de croquis. Je crée plutôt une atmosphère autour de moi. J’ai toujours une vision de ce que je veux faire en tête, mais je ne dessine pas. Je n’utilise pas de moodboard, ni d’échantillons de tissu. C’est davantage un process dans lequel je me plonge petit à petit, pas à pas. Je peux partir d’un livre, d’une musique, d’un souvenir… généralement de quelque chose qui n’a rien à voir, du moins directement, avec la mode. Je suis un designer très émotionnel, je puise beaucoup d’inspiration dans mon enfance pour trouver les matières. Ou alors ce sont elles qui me trouvent. Tout débute par la matière: une fois que je l’ai trouvée, je peux commencer à travailler.
Que ce soit dans les matières, les motifs ou la conception, vos pièces font souvent la part belle à l’artisanat et au savoir-faire marocain.
Bien sûr, c’est mon héritage. Durant mes études d’art et de mode, j’ai réalisé l’importance d’être soi-même. En tant que minorité, je devais revenir à ce qui me rendait unique: mon pays, ma culture, mon peuple, mon histoire, mon héritage. J’y ai énormément puisé, car c’est ce qui définit qui je suis. Quand on a trouvé l’endroit où l’on veut aller, il faut regarder d’où l’on vient. Cela a été une très belle aventure pour moi, à la fois personnelle et artistique. Je ne connaissais pas grand-chose à la culture marocaine et j’ai donc décidé de me plonger dedans pour découvrir d’où je venais et qui j’étais. En tant que designer reconnu, j’ai aujourd’hui la responsabilité de montrer le savoir-faire marocain.
La crise du coronavirus a affecté votre travail, quels sont vos projets ?
Tout a été annulé: les défilés, les robes de mariées, les expositions, les déplacements… J’ai dû apprendre à travailler différemment. Quand la crise a débuté, en mars 2020, j’ai surtout utilisé mon studio pour aider les gens : je distribuais de la nourriture aux sans-abris chaque jour et j’ai aussi conçu des masques pour eux. En parallèle, j’ai développé un projet, baptisé le “Social (Distancing) Fabric”. L’idée ? Je voulais aider les gens à s’occuper durant la pandémie, et pourquoi pas leur faire découvrir une nouvelle technique. J’ai donc dessiné à la main des visages sur du tissu et je les ai envoyés à plus de 200 personnes à travers le monde (qui s’étaient inscrites au préalable) avec des aiguilles et du tissu. Chaque personne était invitée à broder les contours du dessin, selon ses goûts. Les ouvrages terminés me sont renvoyés. Je vais les assembler dans une grande œuvre collective qui sera prochainement exposée dans un musée à Amsterdam. Finalement, “Social (Distancing) Fabric”, c’était une manière positive d’aborder cette période, tout en continuant à créer. Ce projet va donner naissance à une œuvre d’art conçue par 200 personnes qui ne se seront jamais rencontrées. C’est beau.
Par Anaïs FA.
Photo(c) Yaël Temminck.